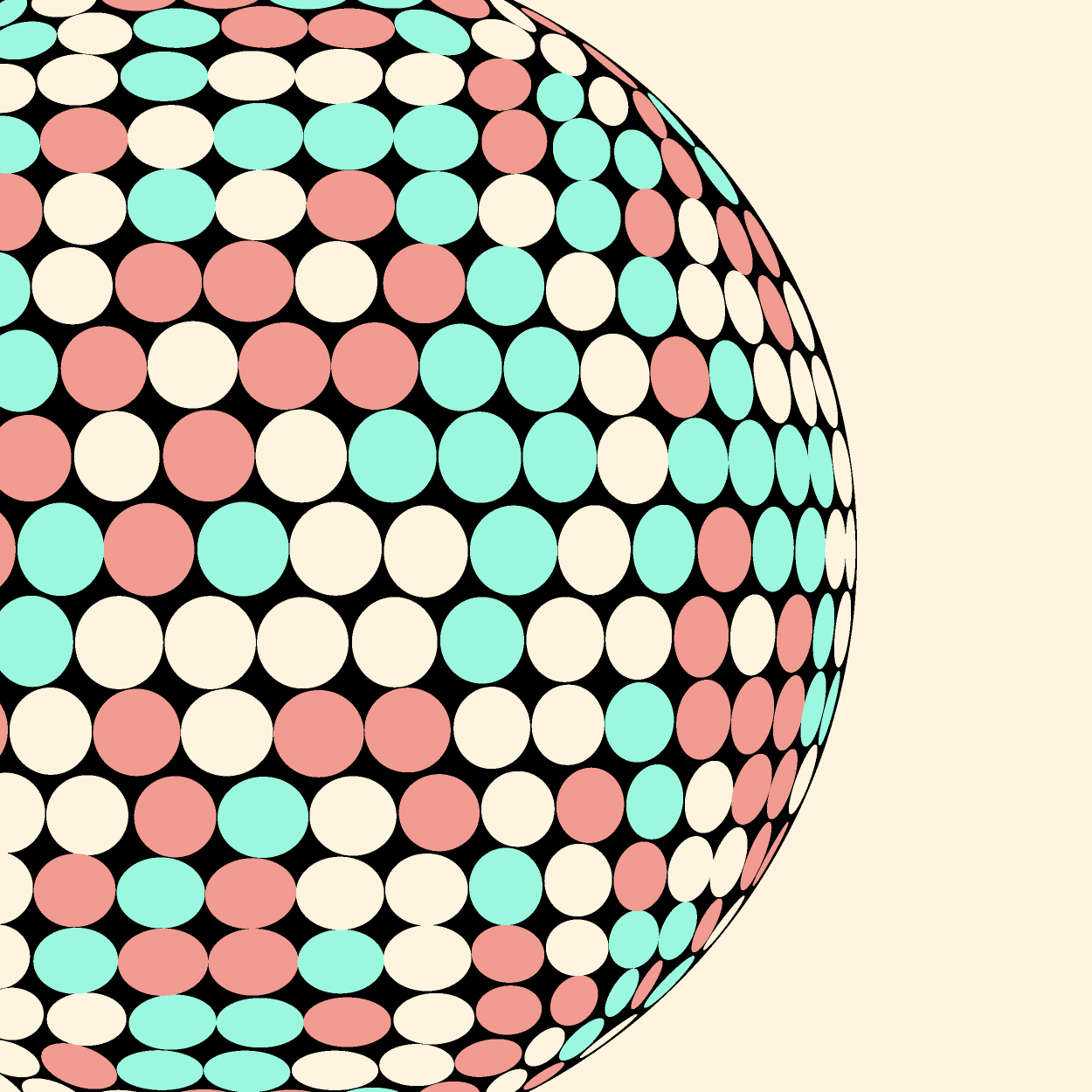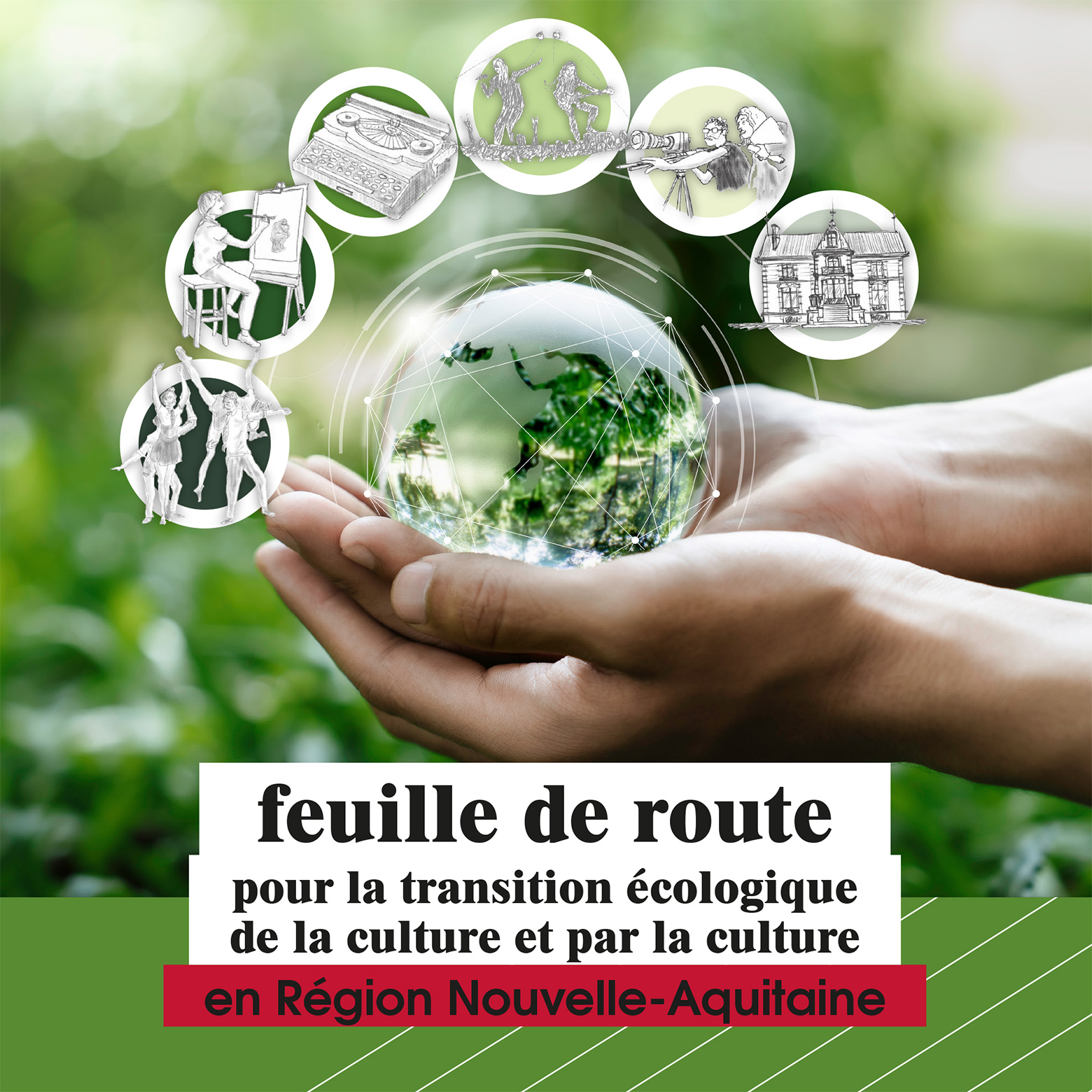
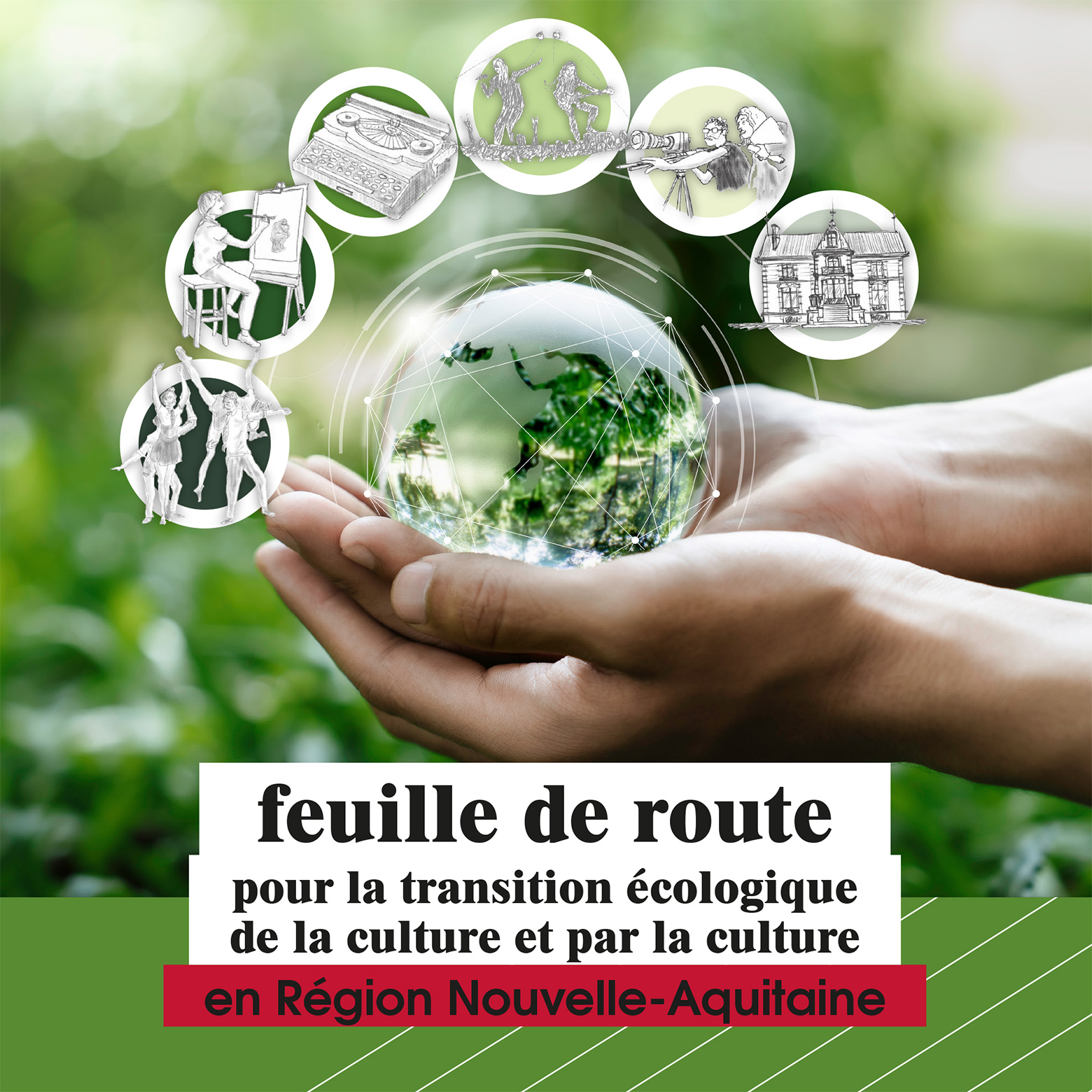






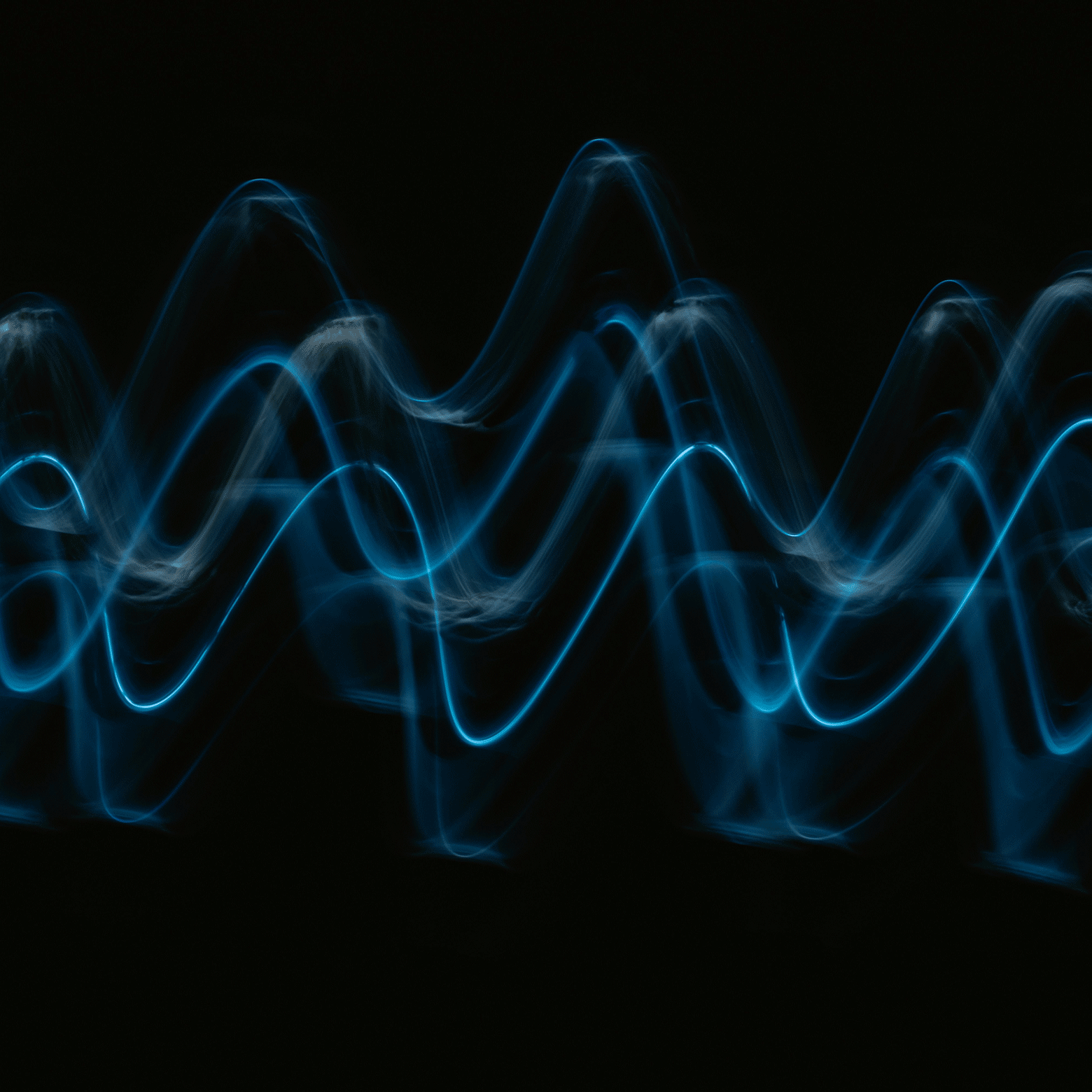
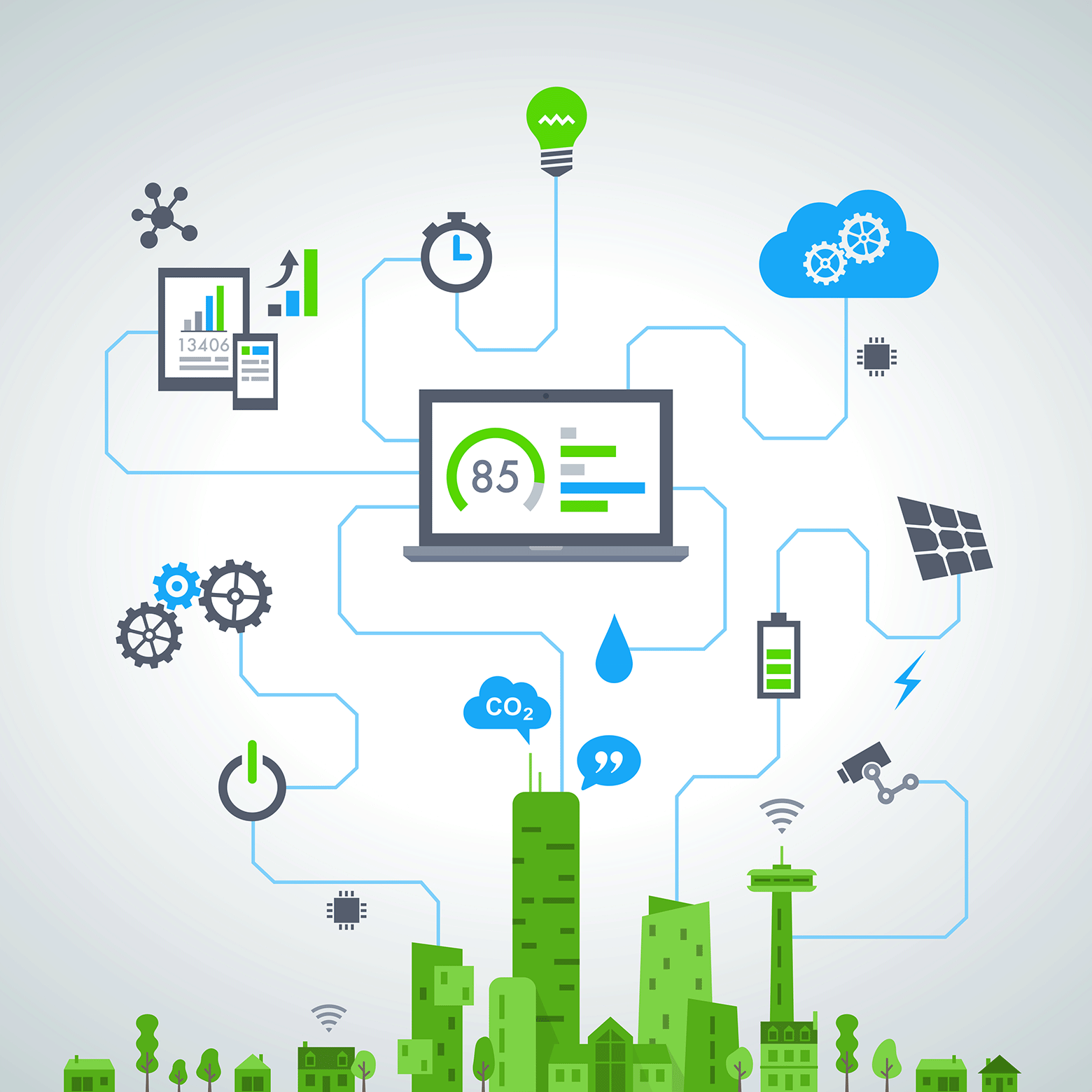
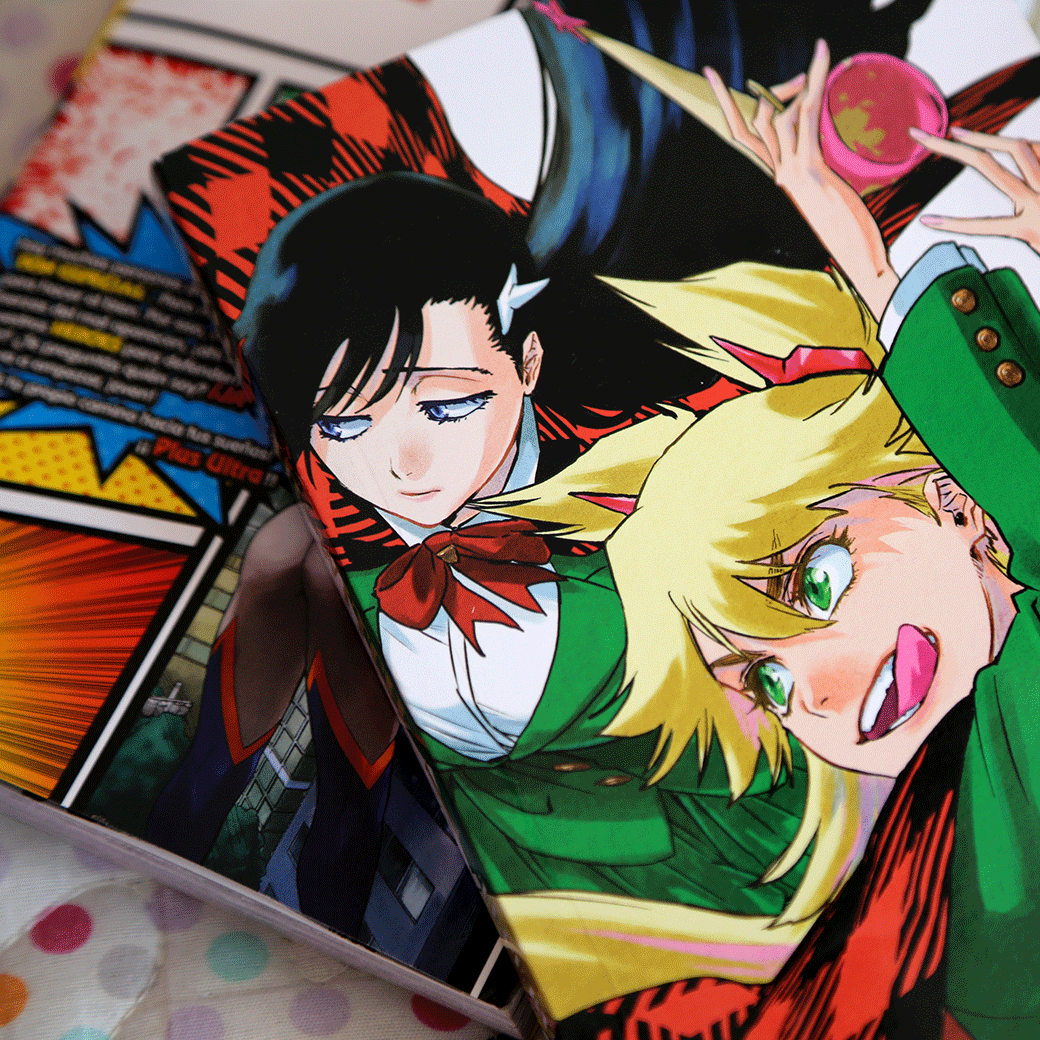

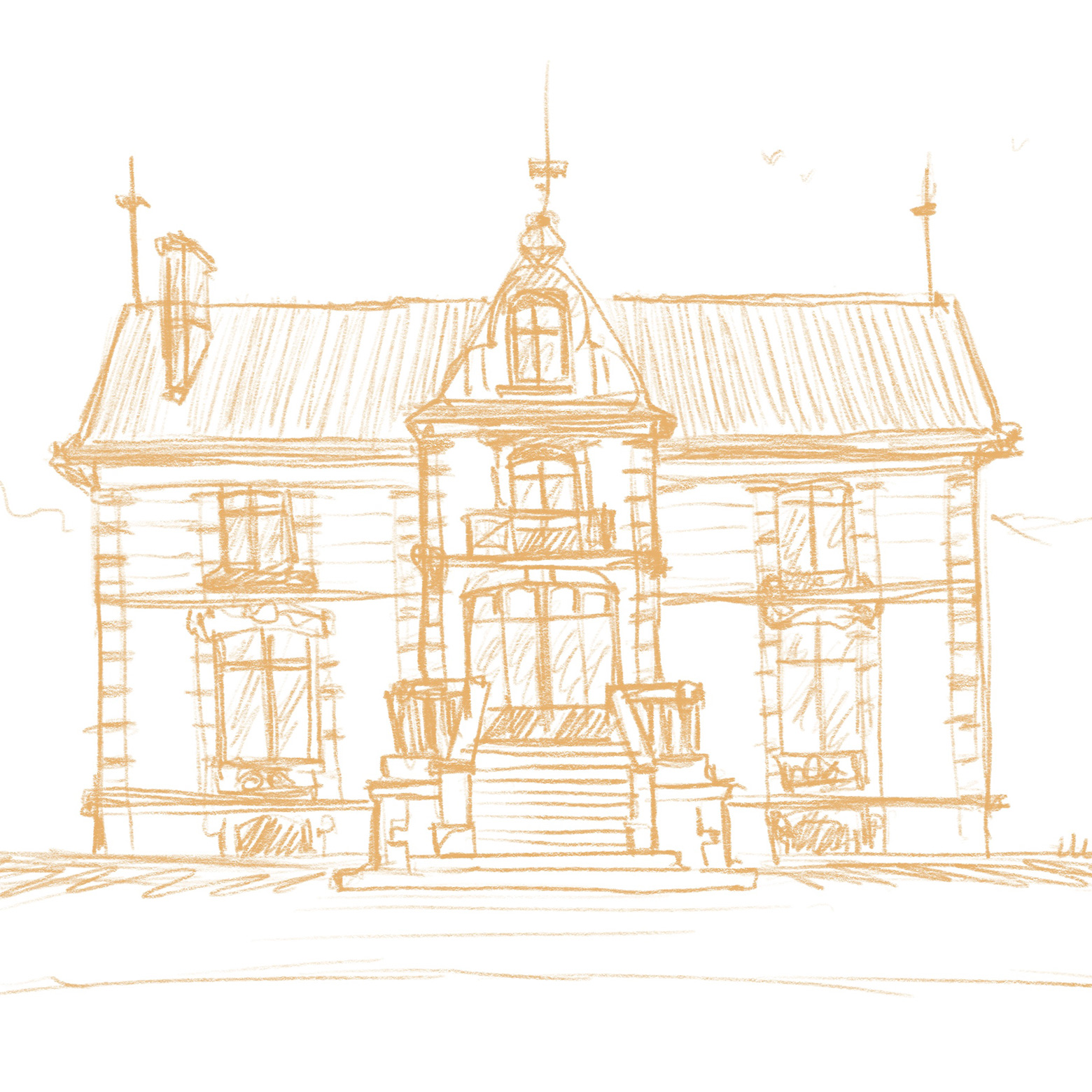


Accompagner la montée en compétences des acteurs du secteur culturel néo-aquitain ; Aider au développement de solutions complémentaires dans les métiers (diffusion, production, création, médiation, gestion) ; Favoriser l’hybridation des projets artistiques ; Favoriser les partenariats intersectoriels.


suivi par la Direction Culture et Patrimoine depuis 2015
Montant total des financements de projets numériques culturel par la Direction Culture et Patrimoine depuis 2015
parmi les bénéficiaire des dispositifs numériques culturels
Gaëlle GERBAULT
Responsable de l’unité Numérique culturel
Tél. : 05 87 21 30 65
Mél. : gaelle.gerbault[@]nouvelle-aquitaine.fr
Franck CABANDÉ
Chargé de mission
Tél. : 05 87 21 30 55
Mél. : franck.cabande[@]nouvelle-aquitaine.fr